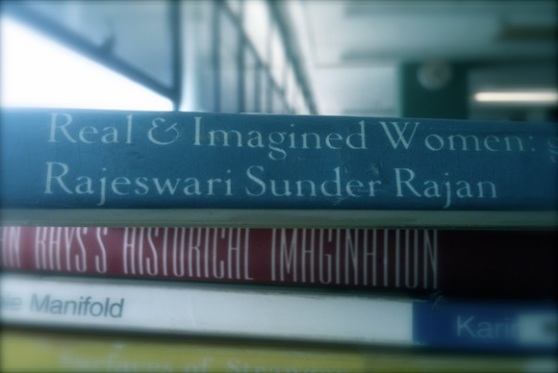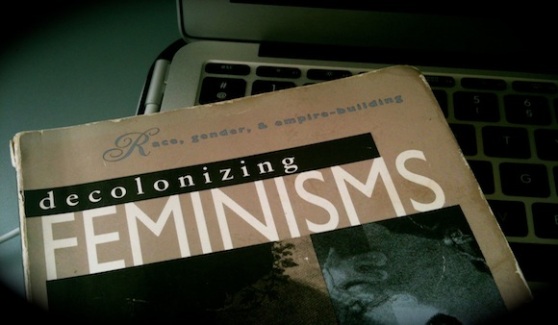Ce court essai écrit par Virginia Woolf en 1929 reprend une série de conférences données à Cambridge, dans deux universités pour femmes.
Il part d’un constat aussi simple qu’affligeant: la présence des femmes dans des universités prestigieuses et célèbres comme Oxford ou Cambridge, est encore marginale mais surtout, mal perçue. Dix ans après l’accession des femmes au droit de vote en 1919, leur statut commence à peine à changer, et il le fait bien trop doucement.
Virginia Woolf retrace ainsi brièvement l’histoire littéraire britannique, en faisant tout particulièrement attention à la participation des femmes à cette histoire. En prenant Shakespeare comme maître étalon du génie, elle constate qu’aucune femme n’est jamais devenue son égale, et s’interroge. Pourquoi, tout d’abord, n’y a t-il jamais eu de célèbre femme écrivain du temps de Shakespeare? En inventant le personnage de Judith Shakespeare, soeur imaginaire du poète, elle imagine quel aurait été le destin de celle-ci, si elle avait eu le même talent que son frère. C’est simple, Judith n’a jamais écrit une ligne, car sa condition ne le lui permettait pas, et elle se suicide après être tombée enceinte. Réjouissant, n’est-ce pas?
Le 19ème siècle, avec des auteurs comme Jane Austen, George Eliot, ou les soeurs Brontë, voit enfin les femmes accéder au statut d’auteur. Mais dans quelle circonstances? Obligées d’écrire cachées, comme Jane Austen? Sous un nom d’emprunt masculin, comme George Eliot? Ou condamnées à cracher leur haine de cette société patriarcale, comme dans Jane Eyre de Charlotte Brontë?
Virginia Woolf se demande alors si les livres de ces auteurs auraient été différents, si les conditions dans lesquelles elles écrivaient avaient elles aussi été différentes. Dépendantes des hommes, financièrement, moralement, les femmes écrivains de cette époque n’ont qu’une liberté toute relative. Pas de revenus propres, pas d’endroit à elles où écrire sans avoir à penser à quoi que ce soit d’autre.
L’argument de Virginia Woolf est donc simple. A une époque où les femmes accèdent à une éducation supérieure, qui n’est dès lors plus uniquement le privilège des hommes, l’auteur enjoint les femmes à saisir toute l’importance des chances qui s’offrent à elles. Virginia Woolf, dont le père Leslie Stephen s’est toujours opposé à l’éducation des femmes, n’a elle jamais eu la chance d’étudier. Ainsi, elle émet le constat suivant: pour prendre leur destin en main, il suffit à ces femmes éduquées de bénéficier d’une chambre rien qu’à elles, où elles puissent s’isoler du reste du monde, et d’une rente de 500 livres par an, pour ne pas avoir à se soucier des questions matérielles.
Essai écrit à la manière d’une fiction, passant à travers le filtre d’un narrateur fictif, A Room of One’s Own n’en est pas moins un pamphlet passionné sur le statut de la femme en général, mais également sur la place de la femme dans les arts, une place qui leur reste à l’époque encore à saisir, et à investir pleinement.
(Titre français: Une Chambre à Soi)
Essai lu dans le cadre du challenge Virginia Woolf chez Lou.